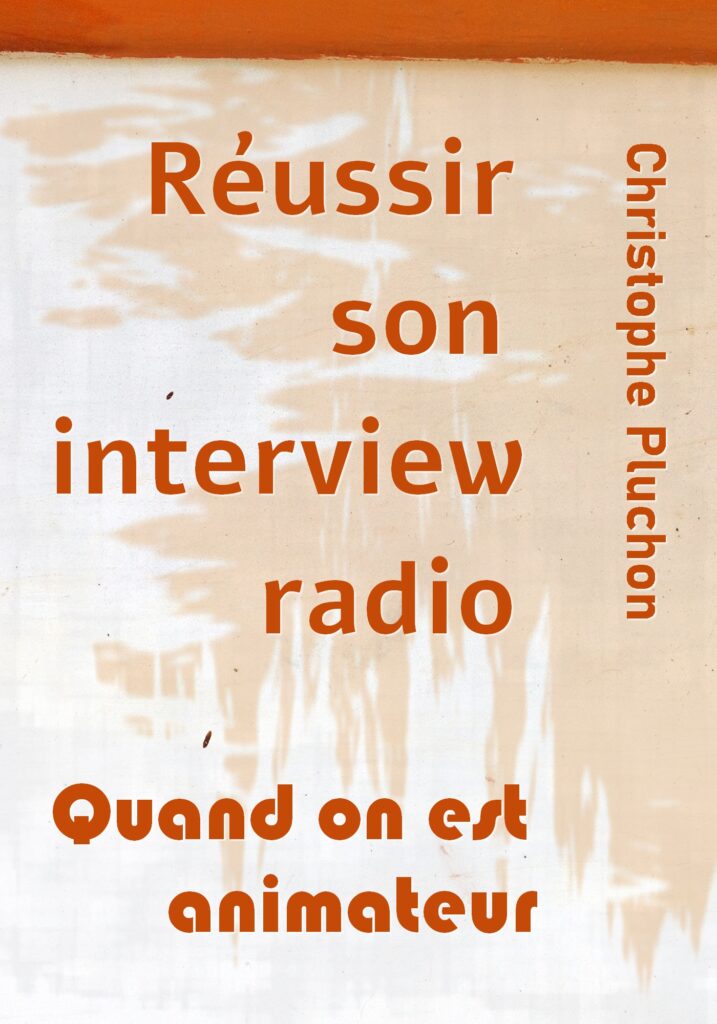
Ce guide vise les animatrices et animateurs et les journalistes des radios (ainsi que les nombreux bénévoles des stations associatives). Il intéresse également les personnes qui organisent des interviews sur le web (du podcast notamment), à la télévision, ainsi que des conférences publiques.
Dans cette publication, nous faisons la distinction entre un son info, un enrobé et une interview.
Ne perdez pas de vue que pendant l’interview radio, on s’adresse à la fois aux auditeurs et aux personnes que l’on interroge. Les auditeurs doivent apprendre quelque chose et avoir des réponses à leurs questions. L’entretien a donc un but pédagogique.
L’intervieweur doit respecter la déontologie journalistique (recherche de la vérité, indépendance — on ne donne pas son point de vue —, dignité des personnes…) et la ligne éditoriale, c’est-à-dire le style de la radio du point de vue rédactionnel.
Chapitre 1 – Les fondamentaux de l’interview radio
Chapitre 2 – Choisir le bon angle
Chapitre 3 – Coller au terrain
Chapitre 4 – Au micro
Chapitre 5 – Anticiper la diffusion
1 – Les fondamentaux de l’interview radio : un média de proximité
Une radio locale accompagne les auditeurs dans leur quotidien. Musicalement d’abord : s’ils se branchent sur telle ou telle station, c’est parce qu’ils y trouvent une ambiance, et le ton d’un animateur ou d’une animatrice qu’ils apprécient particulièrement (et qui a réussi à les fidéliser).
Le ton, la voix, l’accent ou encore les messages délivrés par des personnes interviewées permettent ainsi de renforcer les liens avec les auditeurs. Ceux-ci peuvent s’identifier aux gens du cru, entendre des communiqués locaux (fêtes) ou en diffuser pour le compte d’une association qu’ils dirigent, par exemple.
L’interview ancre le média sur son territoire.
La radio participe, de fait, à l’éducation, à l’enrichissement culturel, au service au public (météo, info-route) et au développement de la consommation avec le publireportage (entretien réalisé à des fins commerciales : tout le texte est écrit, minuté, les mots sont pesés, le message est positif, on insiste sur le nom des marques, et on fait un rappel pratique à la fin).
L’interview permet de donner la parole aux personnes peu médiatisées comme les SDF, les artistes… C’est particulièrement vrai pour le podcast. Les épisodes sont enregistrés par des passionnés souvent bénévoles, et axés sur une thématique comme le féminisme, faire parler les aînés…
La radio fascine
Mais elle fait peur, aussi ! Pourtant, la venue d’un journaliste avec un micro ou une voiture siglée attise la curiosité et créé du lien. On peut aborder les gens assez facilement, et par exemple leur proposer de découvrir le studio, voire d’intervenir à l’antenne pour répondre à une interview.
L’interview est un exercice intéressant pour aller chercher l’information là où on ne l’attend pas, et parfois, pour rencontrer des célébrités !
Le montage et le mixage des sujets permettent aux journalistes, aux animateurs et aux producteurs de podcast de développer leur curiosité et leur créativité.
Enrichissement et valorisation
On acquiert une culture personnelle plus étendue en étant acteur plutôt qu’en écoutant la radio ou en lisant le journal. L’interview permet de recueillir plus d’informations qu’à partir d’un article ou d’un communiqué de presse.
La raison est simple, car l’article ne traite pas tous les aspects d’une question, et le communiqué de presse est partisan car il a été rédigé dans un but promotionnel. Et puis, vous voulez peut-être en savoir plus en menant votre propre entretien ?
Voir les confrères travailler
En allant sur le terrain, vous pouvez voir quel matériel ils utilisent, comment ils posent leurs questions, quels angles ils abordent, comment ils transmettent leurs sujets, et de quelle façon ils utilisent les réseaux sociaux.
Garantir la pérennité de la station
Réaliser des entretiens, des reportages sur la vie locale permet de remplir les critères d’éligibilité au FSER (Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique) qui finance partiellement les radios associatives. Les collectivités et autres partenaires privés y trouvent leur compte également (d’où, parfois, malheureusement, une difficulté à rester objectif dans le choix des sujets).
2 – Choisir le bon angle
Pour une interview pour la radio ou le podcast, vous devez choisir un ou plusieurs angles pour mettre en valeur une personne ou une actualité. Un angle est, pour un sujet donné, une manière d’y répondre, sachant qu’il peut y en avoir une multitude.
Imaginons que vous devez produire un reportage d’une minute trente sur un marché de Noël pour le journal local. Plusieurs possibilités de sujets, et donc d’angles s’offrent à votre micro. Je vous en propose trois, mais pour votre reportage vous ne devez en choisir qu’un seul.
Vous pouvez retenir l’angle de la gastronomie de Noël proposée par les artisans, ou alors l’ambiance de fête qui règne sur le marché, mais vous pouvez aussi profiter d’être sur place pour demander aux passants de confier leurs souvenirs d’enfance (en faisant alors le lien avec le marché de Noël, où vous avez enregistré les témoignages). Vous pouvez aussi faire votre choix sur le terrain, en fonction des éléments sonores et écrits recueillis sur place.
Son info, enrobé, reportage…
L’interview radio peut être diffusée lors d’une émission en direct par exemple, mais si elle est enregistrée sur le terrain, elle doit être montée au préalable. Elle ne peut être dissociée du lancement (ou chapeau) et du pied, à la fin de l’interview.
Le lancement ou chapeau, lu par l’animateur ou un deuxième journaliste, permet, comme son nom l’indique, de lancer l’interview ou le reportage. Il doit suggérer, mais pas répéter le contenu du sujet, afin de donner envie à l’auditeur d’aller plus loin dans la compréhension. Le lancement indique aussi qui a réalisé ce sujet.
Dans le pied, l’animateur (ou le journaliste) remercie le réalisateur. Il peut donner une information complémentaire, en lien avec le sujet ou l’intervenant (des horaires d’ouverture par exemple).
L’ordre de diffusion à l’antenne est donc le suivant : lancement, sujet, pied. Les radios utilisent parfois des formats de sujets qui leur sont propres.
Le son info
C’est le format que l’on retrouve dans les journaux d’information. Il impose de bien définir l’angle du sujet, c’est-à-dire la façon d’y répondre.
Un son info dure entre 40 secondes et une minute en général. Il peut y avoir une relance à l’intérieur, mais elle doit être en accord avec l’angle.
Le micro-trottoir
C’est une série d’interviews réalisée dans la rue (du tout-venant).
Il exprime le sentiment d’une population sur une question précise (un seul angle mais plusieurs points de vue sont possibles).
Le micro-trottoir impose d’alterner voix masculines et voix féminines, sans relance forcément du journaliste, pour donner un rythme à l’ensemble et éviter le côté ennuyeux. Chacune des interventions doit être d’une durée équivalente (pas plus de quinze secondes).
Un micro-trottoir dure une minute le plus souvent.
Le papier info
Le papier permet à un.e journaliste, dans sa voix, d’exposer une problématique et une seule (donc un angle). C’est utile lorsqu’on n’a pas d’interview enregistrée (son, micro-trottoir, enrobé, reportage).
Un papier dure entre quarante secondes et une minute. On le rédige à partir d’une information parue dans la presse, d’un dossier de presse, d’un communiqué de presse, d’informations apportées par une source au téléphone ou par internet, ou par sa propre connaissance du terrain.
En multipliant le type d’éléments sonores, on enrichit et on dynamise un journal radio.
L’enrobé
Il s’agit d’un mini-reportage, où l’information passe au premier plan, au détriment de l’ambiance.
Un enrobé peut durer jusqu’à une minute trente dans un journal d’information. Sa force réside dans la variété de points de vue qu’il permet d’exprimer à partir d’une idée (angle).
Contrairement au micro-trottoir, on doit sentir une progression dans l’enchaînement des idées (contradictions, ouverture sur une nouvelle idée…)
Le journaliste, au contraire du micro-trottoir, relance les intervenants lors du montage en studio.
Comme pour le micro-trottoir, pensez à varier les voix (alternance masculine et féminine) et à restreindre la durée de chaque intervention.
Le reportage
C’est aussi un enrobé, mais qui doit impérativement contenir des éléments d’ambiance comme des chants ou des bruits de rue (s’il s’agit d’une manifestation par exemple).
Les personnes interviewées peuvent se lancer toutes seules pour décrire une action ou leur environnement (ex. je m’appelle, là nous sommes, ici nous voyons, comme ça sent bon le poulet rôti, etc.) Mais le journaliste peut aussi faire ce travail de description, en marchant par exemple.
Pour que le reportage soit un vrai reportage, tous les éléments doivent être enregistrés sur le terrain (il ne faut pas de relance en studio, ni de musique ajoutée depuis un disque).
L’interview longue
L’interview longue (comme un portrait) nécessite une confiance entre les interlocuteurs.
Des respirations musicales, des jingles ou des publicités viennent entrecouper la discussion pour rappeler ensuite, le nom de la radio et de l’invité.
Elle dure une heure sur certaines stations. L’interview longue est un format très présent sous forme de podcast.
3 – Coller au terrain : les profils de personnes à questionner
Attendez-vous à interroger divers types d’interlocuteurs :
Comme l’expert qui connaît son sujet et qui répond volontiers, l’expert mal à l’aise au micro, qui se perd dans ses explications, l’expert mou mais qui connaît son sujet, l’expert qui ne veut pas parler au micro alors qu’il s’est beaucoup exprimé pendant la conférence de presse ou la réunion, l’expert qui ne veut pas parler à la radio ou à la TV, mais seulement à la presse écrite car il a peur que ses propos soient déformés (ou l’inverse), l’expert qui parle une minute sur demande pour un son info…
Vous pouvez aussi avoir à questionner :
L’homme politique, le militant, le leader que l’on interviewe trop souvent et qui ne représente pas la base (un technicien peut avoir un discours plus concret qu’un élu, malheureusement incontournable dans la hiérarchie ou le protocole), le chargé de communication qui se retranche derrière la parole officielle, le témoin pris au hasard dans la foule, l’expert qui mange ses mots, qui parle en patois ou en sigles, la personne qui parle breton qui intéresse un média en langue régionale (le français étant la langue de la République, il est compliqué pour les radios en langue régionale de trouver des interlocuteurs), la personne qui s’exprime dans une langue étrangère, ou régionale, mais non-traduite en français par vous ou par un interprète, etc…
Vous devez choisir le sujet et l’angle en fonction de la cible de la radio ou du podcast, de l’originalité, du caractère affectif ou sensationnel.
Vous n’êtes pas obligé de suivre la presse écrite ni le bruit médiatique. Vous pouvez privilégier la proximité temporelle et/ou géographique.
Vous devez poser des questions simples pour une bonne compréhension de la part de l’auditeur, et pour obtenir des réponses claires de l’interlocuteur.
Ne réalisez pas d’interview si elle n’apporte rien à l’auditeur.
Vous devez soigner le vocabulaire (expliquer, rappeler les faits).
Maîtriser la durée de l’entretien que vous vous êtes fixé est essentiel.
Si vous réalisez une interview de longue durée ou en plusieurs parties ou avec plusieurs intervenants, vous pouvez donner le plan mais ce n’est pas obligatoire.
L’interview doit être dynamique, avec le moins de temps mort possible. Il peut être bon de garder ses questions pour le micro après une conférence de presse pour avoir des informations différentes des confrères. Dans ce cas, laissez les faire leur photo avant.
Se documenter
Les communiqués de presse reçus par mail, les journaux, les réseaux sociaux, les personnes de votre connaissance, votre culture personnelle et les chargés de communication constituent des sources pour une interview.
Vous devez être réactif et au courant si l’actualité de la personne ou de la structure a changé.
Vous devez avoir fait le lien entre l’activité de la structure locale et l’actualité nationale ou internationale (pour réagir sur un sujet : la personne que vous interrogez a peut-être un avis à donner ?)
La prise de contact
Celle-ci se fait par téléphone, par mail, via les réseaux sociaux (X, Facebook, Linkedln…), ou à l’issue d’une réunion si un sujet mérite d’être traité plus en profondeur, dans la rue lors d’une manifestation, un colloque, etc.
Le filtre des attachés de presse et des chargés de communication doit être pris en compte. Leur métier consiste à vous orienter vers le meilleur interlocuteur en fonction de votre sujet (et non pas en fonction de l’intérêt de leur entreprise ou collectivité).
Ne pas hésiter à citer vos sources (à dire à votre interlocuteur que vous souhaitez l’interviewer suite à l’article de tel journal par exemple).
Prévenir que vous allez interroger d’autres personnes peut être à double tranchant si elles sont en conflit (mais ce n’est pas votre problème).
L’objectivité est essentielle : veillez à interroger les pour et les contre
Si vous avez la personne au téléphone ou si vous l’avez déjà rencontrée ou interviewée (par exemple, au moment d’une conférence de presse), vous savez si son propos est intéressant et si elle s’exprime bien au micro. Vous pouvez changer d’interlocuteur, d’angle, ou écrire un papier au lieu de réaliser une interview si ces éléments ne sont pas réunis.
Préparer l’interview
C’est la base : comme dit plus haut, sachez-en un minimum sur le sujet que vous allez traiter ! Ne serait-ce que pour demander à votre interlocuteur d’être plus précis, voire pour le contredire (ne prenez pas ce qu’il vous dit pour argent comptant). Cela relève de la culture personnelle.
Internet est un allié solide. Prenez un temps pour préparer (ne vous jetez pas sur la personne). Ayez à l’esprit toutefois que trop de préparation tue la spontanéité.
Assurez-vous de pouvoir relire vos notes. Demandez si le discours fait doublon avec le dossier de presse s’il s’agit d’une conférence de presse (pour ne pas écrire pour rien).
Dites à l’interlocuteur combien de temps l’interview va durer et (si vous le savez) quand elle sera diffusée ou mise en ligne s’il s’agit d’un épisode de podcast. Vous pourrez ainsi adapter le propos (anticiper l’actualité, par exemple une fête locale, le passage d’une loi à l’Assemblée Nationale…)
Simplifiez, ou expliquez la fonction de la personne interrogée.
Demandez à votre interlocuteur de parler pour votre auditoire (grand public ou spécialisé) en expliquant les sigles, qui sont les personnes citées…
Renseignez-vous sur la prononciation des noms de famille et de lieux pour ne pas commettre d’impair.
Privilégiez un plan et des mots-clés pour éviter le hors-sujet, et bannissez absolument les questions rédigées.
Vous ne pouvez pas parler de tout, surtout en direct, avec votre interlocuteur. Faites donc des choix. Anticipez les parties de l’interview (pensez au montage et à la diffusion), d’où l’importance de bien écouter la personne pour rebondir si elle est hors-sujet ou trop longue dans ses explications.
Accordez-vous avec l’interlocuteur pour délivrer les informations pratiques faciles à retenir à la radio ou en podcast comme la date, le lieu et les horaires.
L’adresse du site internet de la structure doit être mémorisable (sinon, invitez les auditeurs à faire un tour sur un moteur de recherche, sur le site internet de la radio, si l’adresse s’y trouve ou sur les réseaux sociaux).
4 – Au micro : en studio
Voici quelques postures à faire adopter à la personne que vous interviewez.
Soyez intransigeant par rapport aux bruits : bruit de coude, de stylo, de bracelet, de chaise… La bouche doit être à un poing (10 cm) du micro, et vous devez si possible être l’un en face de l’autre pour bouger la tête le moins possible.
Faites des essais de micro avant.
Prévoyez des verres d’eau en studio, et de faire couper les téléphones (ou en mode vibreur).
Le casque peut gêner la spontanéité pour l’interlocuteur et le journaliste.
En extérieur
Côté enregistreurs, vous pouvez préférer un micro avec un câble, un magnétophone avec micro incorporé, voire un smartphone (dont la qualité sonore n’est pas si mauvaise. Vous pouvez même ajouter un micro. C’est pratique lorsqu’on ne peut pas faire autrement).
Vous pouvez aussi choisir d’enregistrer en stéréo les ambiances, et les interviews simples en mono.
Prévoyez une bonnette Rycote (en gros poils gris) en cas de vent et méfiez-vous du bruit des gouttes sur le parapluie et sur l’enregistreur (ploc ploc).
Pour le montage en extérieur, sur smartphone, si vous ne pouvez pas rentrer rapidement à la station, vous pouvez utiliser un site de transfert de fichiers, le mail (en pièce jointe) ou directement un serveur dédié.
Si aucun rendez-vous n’est prévu avec la presse pendant un débat public, vous devrez faire une demande d’interview. Le cas échéant, demandez à brancher votre enregistreur directement sur la sono pour capter les interventions, au lieu de prendre le son depuis les haut-parleurs.
Par téléphone, WhatsApp, Facebook…
Si vous réalisez une interview par téléphone, utilisez un insert téléphonique qui sert à envoyer l’audio dans la table de mixage, et votre voix dans le téléphone de l’interlocuteur.
Faites attention aux niveaux (ça sature vite) et privilégiez le téléphone fixe de la personne plutôt que son portable car le son est souvent meilleur.
Des applications IP grand public (WhatsApp, Facebook Messenger, Zoom…) et professionnelles (ReportIT) permettent de réaliser des directs avec un smartphone. La qualité sonore est meilleure qu’au téléphone à condition d’avoir un bon débit et des oreillettes (ou mieux, un casque-micro), mais cela oblige les deux personnes à utiliser les mêmes applications et logiciels à partir d’un lien.
De bonnes questions ne font pas toujours une bonne interview, si les réponses sont mauvaises et vice-versa. Il faut une homogénéité.
Dans votre introduction, donnez le nom et prénom de la personne, sa fonction, et dites pourquoi vous l’interrogez (le contexte).
Posez bien la question de départ pour le mettre en confiance et pour bien lancer l’interview (c’est le principe de l’entonnoir).
Adoptez le sourire !
Ne tournez pas autour du pot pour rallonger l’interview, mais ayez des questions d’avance par type de sujet (ex. Livres : angoisse de la page blanche, recherches historiques, etc.)
Adaptez votre ton à celui de votre interlocuteur (lui ne s’adaptera pas au vôtre).
Lâchez-vous dans votre manière de vous exprimer, donnez de la voix (mais ne criez pas).
Relancez souvent si la personne est molle ou hésitante.
Ne coupez pas la parole pour gagner en dynamique et par respect pour l’interlocuteur.
En cas d’interview par téléphone, vous et la personne vous ne vous voyez pas, donc il peut oublier qu’on l’écoute (et demander : — vous m’entendez ? – Oui, oui). Prévenez-le avant, ou relancez-le régulièrement. En revanche, l’interlocuteur est moins intimidé qu’en studio car il n’a pas de micro devant lui. Réalisez l’entretien par téléphone ou IP tant que la personne est disponible (vous avez bien cinq minutes ?)
L’interview n’est pas un interrogatoire. Vous devez respecter votre interlocuteur, le flatter pour l’encourager à répondre.
Les questions fermées orientent les réponses. Elles sont à privilégier. Posez une seule et unique question à chaque fois (pas plusieurs questions en une, sinon l’interlocuteur répondra uniquement à la dernière question).
Écoutez bien la réponse pour ne pas perdre le fil (et rebondir), tout en réfléchissant à la question suivante.
Si vous n’avez pas compris la réponse, dites-vous que l’auditeur ne la comprendra pas non plus.
L’auditeur doit avoir une réponse à ses questions.
Ayez des arguments pour expliquer pourquoi vous n’avez pas saisi l’explication, vous qui êtes censé être au courant de l’actualité, et pour contredire votre interlocuteur.
Insistez dans votre interview radio ou votre podcast, s’il est hors-sujet pour qu’il reformule sa réponse.
Soignez votre vocabulaire.
Clarifiez les réponses : demandez d’expliquer les initiales, les sigles, une structure que les auditeurs ne connaissent pas (vous pouvez aussi le faire à sa place).
Attention aux liaisons (on ne dit pas vingt zeuros, quatre zœuvres, etc.)
L’auditeur ne voit pas les peintures dans un musée ni les façades des maisons dans le cadre d’une visite guidée, donc expliquez ou faites expliquer, mais gare aux abus de langage (ex. pour une inondation : Montpellier sous les eaux).
Ne donnez pas trop de chiffres (simplifiez !) car l’auditeur ne peut pas revenir en arrière contrairement à un article de journal.
Vous ne devez pas vous impliquer, mais uniquement poser les questions, c’est-à-dire ne pas répondre à la question à la place de l’interlocuteur.
Ne dites pas : nous sommes heureux de vous recevoir si c’est un homme politique, un partenaire de votre radio, un annonceur… car vous devez rester neutre.
Ne tutoyez pas votre interlocuteur mais au contraire vouvoyez-le, justement pour ne pas exclure vos auditeurs. L’interlocuteur en face n’est ni votre pote, ni celui des auditeurs.
Se détacher des notes nécessite de connaître son sujet pour poser les questions (il ne faut pas lire un texte).
Ne sortez pas vos connaissances de manière démesurée.
5 – Anticiper la diffusion
Si l’entretien est enregistré, pour un épisode de podcast par exemple, il est préférable de reprendre la phrase entière pour le montage et éventuellement la question. Attention au ton et au niveau sonore qui doivent rester les mêmes.
Au montage, on ne coupe pas les respirations, sinon le propos n’est pas naturel.
En studio, notez l’heure de début ou chronométrez l’interview enregistrée, et sur le terrain, ayez un œil sur le compteur de l’enregistreur.
Anticipez la fin de l’entretien en direct pour ne pas devoir le couper précipitamment.
Attention aux interlocuteurs qui terminent leur réponse en remontant la voix, ou qui parlent en même temps que vous. Demandez-leur de reprendre cette dernière phrase pour le montage, ou pour insérer des musiques ou un générique.
Ne dites pas hum ou ok ou oui d’accord pendant la réponse (sinon cela s’entend au micro et vous ne pourrez pas effacer). Hochez au contraire la tête pour l’encourager et levez le doigt si vous envisagez de l’interrompre (mettez-vous d’accord avant pour qu’il comprenne votre intention).
Sur le terrain, notez ou enregistrez au micro ce que vous voyez, ce que vous entendez et ce que vous sentez (slogans, fumet d’un plat, chant des oiseaux…) et essayez de décrire au micro le plus possible.
Vous pouvez demander à un manifestant dans un défilé d’expliquer ce qui est écrit sur sa banderole. C’est une manière pour l’image et le son de se rejoindre. Cela vous sera utile pour l’écriture du papier (lancement, relances, pied).
Enregistrez des bruits d’ambiance séparément des interviews et éloignez-vous des bruits perturbateurs (enceintes, voitures).
Faites comprendre aux personnes autour que vous êtes en train d’enregistrer des bruits d’ambiance pendant deux ou trois minutes pour ne pas être embêté lorsque vous passerez à l’étape du montage.
Comment, en effet, supprimer proprement au montage, une hésitation alors qu’une voiture démarre ou ralentit en fond ? La solution est soit de faire reprendre la phrase entière en milieu sonore neutre (mais quid de la résonance du lieu qui ne correspond pas à celle de la phrase précédente ?), soit d’avoir de la matière sonore supplémentaire pour la mixer. Concrètement, en reportage, vos oreilles doivent à la fois écouter l’interlocuteur et les bruits perturbateurs.
Il existe des applications gratuites qui convertissent un fichier numérique (sonore) en texte. Le démarrage de chaque phrase est indiqué à la seconde près, ce qui est utile pour savoir ce qui s’est dit dans une interview longue et éviter les redites lors du montage.
Vous devrez réaliser ce montage le plus vite possible afin que votre esprit soit dans l’ambiance de ce que vous avez vu, ressenti et enregistré.
Sur Windows et sur Mac, les logiciels gratuits les plus utilisés pour monter et mixer les interviews et les reportages pour la radio et le podcast sont Audacity et Reaper.
Les relances
Rappelez l’identité de votre interlocuteur toutes les deux questions ou au moins toutes les cinq minutes.
Donnez le nom du média et le thème de l’interview, mais de manière plus espacée que l’identité. Cette réflexion est plus indiquée à la radio, puisqu’en podcast l’auditeur a choisi le thème et l’épisode, et le nom de l’interlocuteur ou de l’interlocutrice apparaît sur son écran.
Notez qu’avec la radio numérique (DAB+) ces informations sont parfois aussi accessibles en fonction des postes.
La fin de l’interview
Coupez l’interview si la réponse est trop longue en profitant d’un mot-clé qui se rapproche de la question que vous désirez poser (et justement, vous parlez de…)
Soyez convivial (merci d’avoir pris le temps), mais ne vous montrez pas trop proche de la personne surtout si vous la connaissez bien.
Remerciez (nom, prénom, fonction), rappelez le rendez-vous, mais les coordonnées internet et le téléphone c’est secondaire, car les auditeurs n’ont ni le temps ni le réflexe d’écrire.
Voilà, j’espère que ce petit guide vous permettra d’approcher sereinement l’interview radio !
Christophe Pluchon, avril 2025
